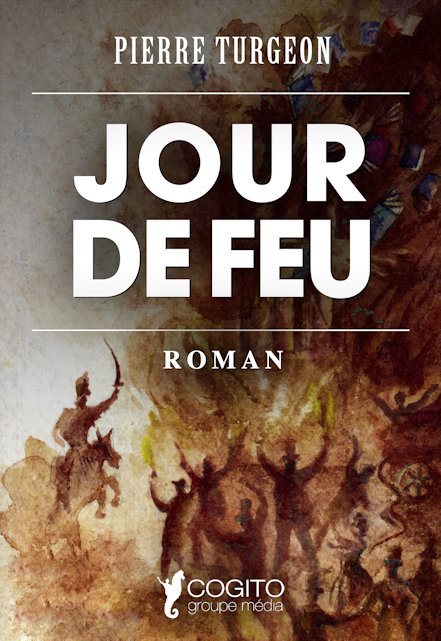En octobre 1918, l’Empire russe s’écroula et le Canada devint pour un temps le pays doté de la plus grande superficie au monde. L’homme le plus puissant et le plus détesté du plus grand pays de la planète s’appelait Michael Parker : il était mon grand-oncle. Il gouvernait ses compatriotes comme un astre invisible régit ses satellites. Le Canada lui appartenait, des quais de Vancouver où ses trains rejoignaient ses navires du Canadian Pacific jusqu’à la pointe sud-est de Terre-Neuve, d’où ses câbles télégraphiques prolon-geaient l’Amérique vers l’Europe.
En 1928, il fit construire, rue Saint-Jacques à Montréal, le plus haut gratte-ciel de l’Empire britannique. Aujourd’hui, d’autres édifices le surpassent, mais la Tour royale reste inégalée en arrogance architecturale. Dans le hall cyclopéen, les caissières officient à des comptoirs de marbre de Levanto ornés de guichets et de portillons de bronze solide.
De son bureau du dernier étage, Michael Parker contemplait la ville étendue à ses pieds et, tracées sous les nuages, les lignes blanches que des projecteurs aéroportuaires dressaient vers le ciel depuis les quatre coins de son gratte-ciel. Il ne souffrait sûrement pas de vertige : aux commandes de son hydravion, il décollait du port de Montréal vers son palais florentin, construit dans l’île de Navy, juste en amont des chutes Niagara. Dans cette même île, en 1837, William Lyon Mackenzie et ses camarades Patriotes du Haut-Canada avaient installé le siège de leur gouvernement provisoire après avoir échoué à s’emparer de Toronto.
Michael Parker se posait impeccablement dans la crique, qui le mettait à l’abri des courants destructeurs de la rivière Niagara. Puis il extirpait sa maîtresse du poste de passager et montait faire l’amour avec elle dans la tour sud de son château. Sous sa fenêtre déferlaient les six mille mètres cubes d’eau qui, chaque seconde, tombant d’une hauteur de cinquante mètres, actionnaient les turbines de sa centrale de Niagara. Il venait de prendre le contrôle de cette usine par cette manœuvre boursière appelée tout ou rien qui lui permettait de s’emparer des biens de ceux qu’il avait acculés à la faillite.
Il possédait l’île d’Anticosti, les tramways de Rio de Janeiro, les forêts de la Mauricie, des gouvernements entiers dans les Barbades, en Afrique équatoriale et dans les pays baltes. Il avait choisi Montréal comme capitale de cet empire financier.
Plus puissant que le premier ministre d’alors, il a pourtant tra¬versé l’histoire sans laisser de traces. Cette disparition, il l’avait souhaitée et même soigneusement organisée. Il a veillé personnellement à la destruction systématique des archives qui le mentionnaient de loin ou de près. Il a refusé d’accorder toute interview, sous prétexte que ses propos, rapportés fidèlement ou non, serviraient ses ennemis. Une seule photo de lui circula, celle d’un dandy de trente ans, aux cheveux noirs gominés et aplatis sur le crâne, avec des lèvres minces et une cicatrice sous l’œil gauche, de sorte que, à mesure qu’il vieillissait — il mourut à quatre-vingt-huit ans —, ce portrait ressemblait de moins en moins à son modèle.
Cette discrétion s’explique en partie par les multiples attentats dont il fut la cible, mais aussi parce qu’il croyait pouvoir triompher de ses adversaires en leur cachant tout de lui et de ses véritables intentions. Il arriva si bien à se dissimuler de son vivant qu’on croirait aujourd’hui, plus de cinquante ans après sa mort, qu’il n’a jamais existé.
J’habite tout près de la tour de mon grand-oncle. Elle devient pour moi, quand je m’installe à son sommet, un immense vaisseau à voyager dans le temps. Par l’imagination, j’éteins une à une les lumières de Montréal. Quand il ne reste plus rien qu’un petit filet de lumière, diffus et agonisant, je sais que je suis rendu là où je dois reprendre le fil de mon récit, au milieu du dix-neuvième siècle.