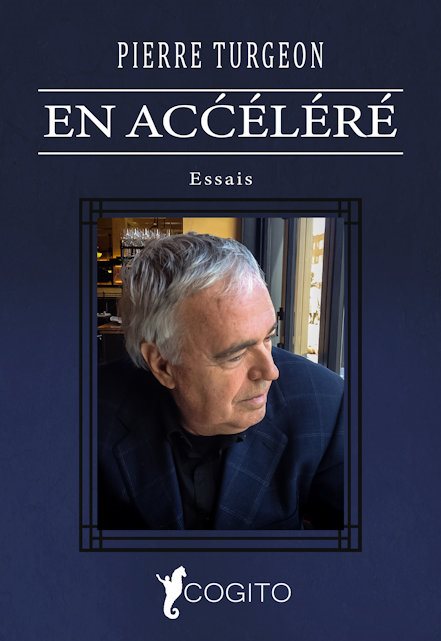À propos du livre
En accéléré Cogito, 2020
Sept carnets conservés entre 1968 et 1991, dans lesquels Pierre Turgeon explore son rapport à l’écriture et à la réalité absolue. Sept carnets collectés qui dépassent l’anecdote et l’état d’esprit pour nous emmener, avec l’auteur, dans les coulisses et sous les coulisses de l’acte d’écrire, dans l’identité d’un écrivain-romancier-journaliste, scénariste-éditeur. Pierre Turgeon de l’intérieur : l’univers secret de sa psyché, où la fantaisie et le rêve côtoient la liberté, les coins sombres et lumineux : lieux de création, espace du regard intérieur, en Grèce, à Paris, au Mexique, à Berlin, à Montréal, à Philadelphie. A chaque mot, Turgeon plonge dans le connu et l’inconnu qui le définit et qu’il explore à travers l’écriture de cette plongée.
En accéléré
Essai
Pierre Turgeon
Je me promène dans les couloirs de la pensée occidentale. Je suis une tortue qui transporte ses livres sous sa carapace. Je ne suis pas fait pour la vérité. Pas plus que pour la pensée.
Je ne veux plus rien posséder. Je me contenterai d’une carte d’abonnement à la bibliothèque. Mangerai du riz brun. Ne voyagerai plus que par le rêve. M’enfoncerai dans la grande caverne de Platon. Attendrai que le froid des glaciers m’im¬mobilise en totem. Ne plus bouger. Oh oui ! ne plus souffrir!
Il faut se perdre dans l’illusion pour retarder les oiseaux charognards qui se tiennent sur les fils télé¬ graphiques de la conscience. L’or du Rhin me donne des pierres à la vessie. La lune dans son dernier croissant appâte l’astre noir prédateur qui nous gobera tous.
Le droit fil se tord et se rompt dès qu’on cherche à se justifier. Le monde est la totalité de nos actes. Il n’y aura jamais rien d’autre. J’écoute les voiles qui claquent dans le port, les vagues qui clapotent sur les coques vermoulues. Je fume des cigares et je bois des planters’ punchs.
Je n’ai plus la force de continuer. J’avais de l’argent, à crédit ; du pouvoir sur les autres, aucun sur moi-même. Je voudrais simplement un peu d’amour sans la guerre.
Cauchemars : la syphilis m’a rendu débile : pour gagner un peu d’argent, je fais le clown sur les trot¬toirs. Je lance mon fils par une fenêtre du dixième étage. Je me retrouve chez mes parents où je suis compris et aimé.
Beaux rêves : je deviens invisible, ou femme, à volonté. Je reste seul sur la terre. Je ne me réveille plus. Il n’y a plus rien après la mort.
Le seul élément vrai et fort : la famille. Je ne pourrais pas rendre ma famille malheureuse. Voilà la limite de mes expériences mystiques, de mes tentations de suicide ou de fuite. S’agit-il d’amour? De peur? Jamais je ne pourrais faire pleurer ma femme ou mes enfants. Mes idées les plus noires ne m’y amèneront pas. J’appartiens plus à ma famille qu’à mes affaires, qu’à mon désespoir. Je trouve là mon absolu, du moins sur le plan de l’action. De la morale également. Au fond, mes proches se passeraient de moi admirablement. Ils ne semblent pas avoir souffert de mes nombreux voyages. ·
À Mexico, je monte jusqu’à la dernière marche d’un escalier ténébreux et m’assois au haut d’un gratte-ciel sans fenêtres, sachant que je domine un paysage de montagnes et de forêts qui demeure invisible derrière les murailles de pierre. Pourquoi diable construire ainsi une tour sans meurtrières, sans ouvertures ?
La pluie, venue du nord, s’étend sur la morne, l’humide journée. Rideau mouvant, sale et effiloché. Les hangars de la Foire du livre de Francfort s’érigent en désordre au milieu de l’immense parking. De la fumée de cuisson s’élève déjà des barbecues des stands à saucisses et à bière. L’été touche à sa fin. Il pleut de l’encre. Assis dans ma Ford de location rangée en face du Halle Fünf, qui abrite les éditeurs étrangers, j’observe la pluie. Pour l’instant, je profite d’un moment de stupeur. Mon visage triangulaire, aux traits délicats, n’exprime aucune émotion.
Il me semble que les chiens aboient pour expulser la suie de leurs poumons. Ils tirent sur leur laisse tenue par des policiers en uniforme vert pâle. Du côté d’où souffle le vent, le pare-brise se strie d’eau et, à travers les gouttes, tout se déforme, alors que la vue reste encore claire du côté du parking. Un homme trapu, grisonnant, qui frôle la soixantaine, sort d’une BMW et s’approche en oscillant. Je remonte le col de mon imperméable, renoue mon écharpe et avale une gorgée de Pepto-Bismol. Soudain je jure entre mes dents à l’idée que mon banquier risque de rappeler ma marge de crédit.
Je n’en peux plus, je m’étais montré très patient, soudain les morceaux se décollent, l’assemblage se détruit, rien ne permet de croire à une future solution. J’ai le goût de pleurer, de disparaître, de ne plus mentir, de ne plus délirer. Dans le grand ciel, les oiseaux volent, pas ici, dans ma tête. À l’instar de Zénon d’Élée, j’ai conclu à l’impossibilité de tout véritable mouvement, ce qui me fait trembler d’horreur. Incapable de me divertir, je n’ai plus d’autre choix que de sentir les dettes me ronger. Glaces ouvertes sur le parking couvert d’exposants.
Mes pensées sont une série de tortures infimes que je m’inflige moi-même. Le désespoir à fleur d’abdomen, les mains moites et la gorge qui pique, le corps à l’heure de Montréal, mais le cul sur une chaise de mon stand à Francfort, je ferme les paupières sur mes lentilles cornéennes. Quand j’avais de l’argent, je n’avais pas besoin de penser. Sauf que je le faisais quand même. Ce qui me gâchait l’existence.
Je ne sais plus rien, pas même si je suis humain. Pas sûr d’avoir un père et une mère, que les gens existent quand je ne suis plus là pour les regarder, ni que je vais disparaître après ma mort. Je me prosterne devant mon propre nom, qui est ma marque. Je saigne du nez. Mon virement bancaire me manque autant que sa dose d’héroïne au junkie. C’est l’aube à Francfort. J’attends mes créanciers. Je voudrais qu’on me dépossède. Je voudrais devenir un homme sans affaires.
Lu dans Kundera une présentation des petites littératures nationales où son esprit d’entomologiste décrit à merveille la situation de la littérature québécoise. Il parle de l’absence d’écrivains franchement mauvais, de la nécessité pour chacun de défendre la part d’histoire littéraire qui lui revient même s’il ne la connaît pas, ni ne l’aime.
Cette analyse devrait être enseignée à tous les étudiants de littérature québécoise. Les salles de cours se videraient.
Ma facilité de compréhension des textes que je lis forme une excellente manière de mesurer mon niveau de perturbation et de stress. Moins je com prends, plus je suis perturbé. Je deviens même complètement stupide, incapable de lire une ligne. Dans ces moments, il faut que j’écrive ou que je coure.
Dans le creux de l’oreille, entre la salive et la cire, dans les trombes méandreuses, il n’y a rien à entendre : au fond de la gorge, entre la déglutition et la respiration, il n’y a rien à dire. Et derrière l’œil, il n’y a rien à voir. Généralement j’essaie de me tenir là, avant que tout arrive et se gâte. Pas moyen d’y échapper : je dois sortir, pour manger, boire et parler. Et après, quand je veux revenir, je me retrouve enfermé dehors. Exilé de mes sens, expulsé de ma peau. Alors j’en profite pour reprogrammer le robot. J’efface des fichiers magné tiques, modifie certaines adresses de la mémoire, relance des sous-programmes de sentiments et essaie d’augmenter la vitesse d’exécution. J’améliore le modèle.
Au bout de l’expiration, on trouve l’inspiration. Une question de souffle, on l’a toujours dit. Le cou rage vient de l’abdomen. On décide avec son nombril.
Je veux connaître mes coordonnées véritables entre Sirius et le Soleil, entre le Big Bang et le trou noir terminal. Je ne peux aller ailleurs qu’ici, ce qui me fait trembler d’horreur. Incapable de me divertir, je n’ai plus d’autre choix que d’écouter les vers me ronger. Le dernier mot, personne ne le dit, ça continue ainsi sans répit, pour aucune raison, sans besoin d’être nommé, expliqué, compris. Parce que les instructions forment une boucle infinie, que les neurones scintillent aussi nombreux que les étoiles dans le cerveau. Les oubliettes orgasmiques de la naissance-mort nous avalent goulûment sans que jamais nous trouvions ne fût-ce qu’un milliardième de centimètre cube qui nous appartienne. Tout vu, tout connu. Chaque visage de femme, chaque forme possible de mon expérience. Les êtres humains paraissent enfantins. La seule nouveauté qui reste: la mort l’apporterait J’ai posé ma montre sur le bureau. Je me donne une heure pour me retrouver, ici, dans cette chambre dominant la plage de Fort Lauderdale. Je pourrais me trouver à Venise, Rome, Paris, Montréal, ce serait le même décor de Holiday Inn, si je fais exception de la vue de la fenêtre. Le miroir ressemble à ces pièges de la quatrième dimension où les Kryptoniens enferment leurs criminels; j’y vois mon visage : yeux verts, cheveux noirs grisonnant aux tempes. Ma mère me disait de ne pas jouer dehors. Et dedans ? Rien ne m’a préparé à me défendre contre celui qui apparaît dans le miroir, qui sourit, et qui, dès que je tourne le dos, découvre ses canines et enlève son masque.
La mort n’est qu’un manque de parole
Quand l’esprit de Dieu planait sur les eaux, déjà elles sentaient mauvais. On peut tirer la chasse et emporter tout cela dans les égouts d’avant la création du monde.
Je dévore mon corps de l’intérieur. Je le laisse vidé de sa substance.
PIERRE TURGEON
Né à Québec, le 9 octobre 1947 – Le romancier et essayiste Pierre Turgeon obtient un baccalauréat en lettres en 1967. En 1969, à l’âge de vingt-deux ans, déjà journaliste à Perspectives et critique littéraire à Radio-Canada, Pierre Turgeon crée la revue littéraire L’Illettré avec Victor-Lévy Beaulieu. La même année, il publie son premier roman, Faire sa mort comme faire l’amour. Plusieurs ouvrages ont suivi, 22 titres au total : romans, essais, pièces de théâtre, scénarios de films et ouvrages historiques. Mentionnons La première personne et La Radissonie, qui remportent tous deux le prix du Gouverneur général, respectivement pour le roman et l’essai.
En 1975, il fonde la maison d’édition Quinze, qu’il préside jusqu’en 1978. Il y publie de nombreux auteurs, dont Marie-Claire Blais, Gérard Bessette, Jacques Godbout, Yves Thériault, Jacques Hébert et Hubert Aquin, avant de devenir directeur adjoint des Presses de l’université de Montréal (PUM) en 1978. Puis, de 1979 à 1982, il dirige les éditions du groupe Sogides, le plus important éditeur de langue française en Amérique. (L’Homme, Le Jour, Les Quinze). Il publie aussi des logiciels, lançant l’un des premiers éditeurs de texte français (Ultratexte) et le premier programme français de correction orthographique (Hugo). Rédacteur en chef, de 1987 à 1998, de la revue littéraire Liberté, il édite des numéros controversés sur la crise d’Octobre et sur la crise d’Oka, ainsi que sur divers sujets politiques et culturels.
En 1999, il crée Trait d’union, une maison d’édition consacrée à la poésie, aux essais et aux biographies de célébrités, ouvrages signés entre autres, par René Lévesque, Pierre Godin, Micheline Lachance, Margaret Atwood,. Il est le seul éditeur canadien à avoir vu l’un de ses livres, une biographie de Michael Jackson Unmasked, atteindre la première place de la liste des best-sellers du New York Times. En attendant, l’auteur continue d’être prolifique et en 2000, il publie une histoire du Canada, en collaboration avec Don Gilmor, qui remporte le prix Ex-Libris, décerné par l’Association des libraires canadiens avec la mention de Meilleure histoire du Canada à ce jour.
Aujourd’hui, il travaille à la création d’un site d’édition entièrement consacré à la distribution de livres électroniques anglais et français : Cogito, qui sera mis en ligne au début de 2021.
Comment, pourquoi est-on écrivain? La réponse de Pierre Turgeon est assez simple : on écrit pour participer à la “communion des saints que constitue une bibliothèque” et parce qu’on veut avoir “une place, après sa mort, auprès des morts”. Pierre Turgeon écrit très bien, sans aucune prétention, avec un côté goguenard très attachant. Un livre élégant, dandy, policé. – Jean Basile, Le Devoir.